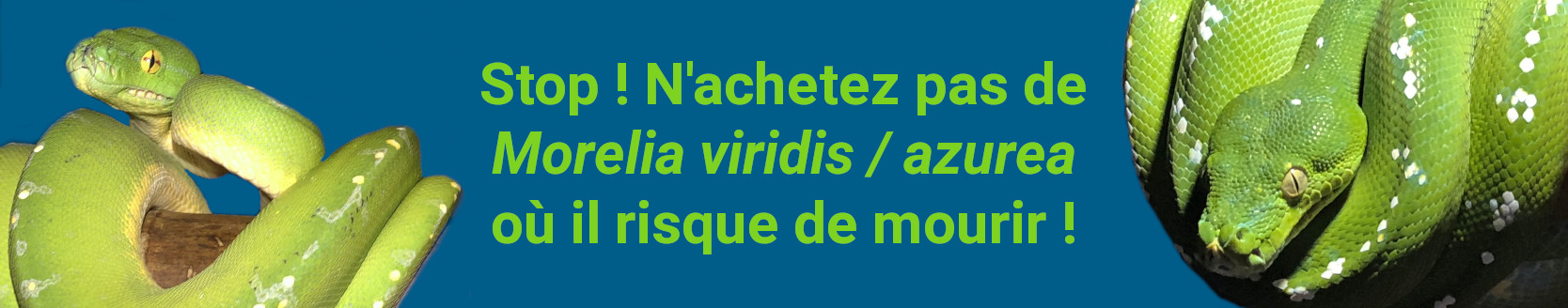Naja ashei : Cobra cracheur d’Ashe ou Cobra cracheur géant
Grand Est, FRANCE, le 13 février 2024, le Naja ashei.De : Sébastien KENNEL La description de le Naja ashei C’est un serpent terricole et qui est présent en Afrique. Il possède la capacité d’envenimation, comme c’est le cas de tous les Naja. Ainsi, il s’agit d’un serpent venimeux. Ils ne possèdent pas de fossettes thermosensibles […]
Naja arabica : Cobra arabe ou Cobra d’Arabie
Grand Est, FRANCE, le 13 février 2024, le Naja arabica.De : Sébastien KENNEL La description de le Naja arabica C’est un reptile qui est terricole vivant dans des milieux désertiques arides. Ensuite, comme tous les Naja, il a la capacité d’envenimation ce qui fait de lui un serpent venimeux. En outre, il possède des pupilles […]
Naja annulifera : Cobra muselé ou Cobra égyptien annelé
Grand Est, FRANCE, le 12 février 2024, le Naja annulifera.De : Sébastien KENNEL La description de le Naja annulifera Il s’agit d’un Naja qui est terricole venant de l’Afrique. Il possède la capacité d’envenimation, ce qui fait de lui un serpent venimeux. Ses activités sont plutôt diurnes, ce qui se remarque par la présence de […]
Naja annulata : Cobra d’eau
Grand Est, FRANCE, le 11 février 2024, le Naja annulata.De : Sébastien KENNEL La description de le Naja annulata Il s’agit d’un Naja qui a la particularité d’être semi-aquatique, qui est présent en Afrique centrale. C’est un serpent qui a la capacité d’envenimation. Ainsi, il est un serpent venimeux. Ensuite, c’est un animal qui possède […]
Naja anchietae : Cobra d’Anchieta
Grand Est, FRANCE, le 10 février 2024, le Naja anchietae.De : Sébastien KENNEL La description de le Naja anchietae C’est un serpent terricole, ce qui se voit bien par ces couleurs et ce Naja est présent en Afrique. Il s’agit aussi d’un animal qui a la capacité d’envenimation. Lorsqu’il fait sa coiffe cela indique qu’il […]
Oxyuranus temporalis : Taïpan du dessert occidental
Grand Est, FRANCE, le 3 février 2024, l’Oxyuranus temporalis.De : Sébastien KENNEL La description de l’Oxyuranus temporalis C’est un serpent terricole où il y a eu sa découverte assez récemment, vivant dans les zones arides. Il possède la capacité d’envenimation, ce qui fait de lui un serpent venimeux. Ensuite, il ne possède pas de fossettes […]
Oxyuranus scutellatus : Taïpan côtier et Taïpan de Papouasie
Grand Est, FRANCE, le 2 février 2024, l’Oxyuranus scutellatus.De : Sébastien KENNEL La description de l’Oxyuranus scutellatus C’est un serpent terricole vivant près des côtes. Et c’est un reptile qui a la capacité d’envenimation, ce qui fait de lui un serpent venimeux. Ensuite, c’est un animal qui est plutôt diurne ce qui se remarque par […]
Oxyuranus microlepidotus : Taïpan du dessert oriental
Grand Est, FRANCE, le 1 février 2024, l’Oxyuranus microlepidotus.De : Sébastien KENNEL La description de l’Oxyuranus microlepidotus C’est un serpent terricole qui vit dans les milieux désertiques qui sont arides. En outre, c’est un serpent qui a la capacité d’envenimation, ce qui fait de lui un serpent venimeux. Ensuite, il possède aussi des yeux avec […]
Dendroaspis polylepis : Mamba noir
Grand Est, FRANCE, le 31 janvier 2024, le Dendroaspis polylepis.De : Sébastien KENNEL La description du Dendroaspis polylepis C’est un serpent africain qui a la particularité d’avoir la gueule noire, d’où son nom vernaculaire « mamba noir ». Il est semi-arboricole contrairement aux autres espèces de Dendroaspis qui sont vraiment arboricoles. Ensuite, c’est aussi un […]
Dendroaspis viridis : Mamba vert de l’Ouest
Grand Est, FRANCE, le 30 janvier 2024, le Dendroaspis viridis.De : Sébastien KENNEL La description du Dendroaspis viridis C’est un serpent vert vif africain qui est arboricole. De ce fait, il possède une queue qui est préhensile. De plus, c’est un reptile qui a la capacité d’envenimation. Ce qui fait de lui un serpent venimeux. […]