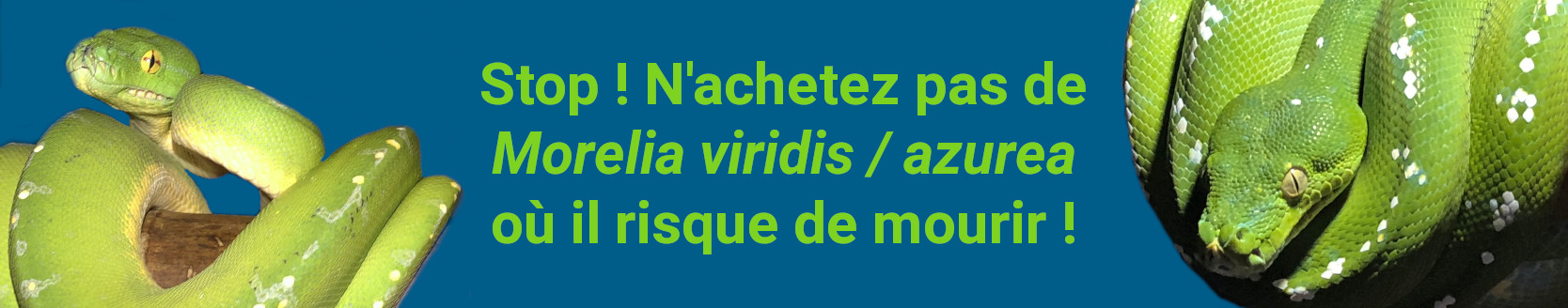Naja nana : Cobra d’eau nain
Grand Est, FRANCE, le 26 février 2024, le Naja nana.De : Sébastien KENNEL La description de le Naja nana C’est un serpent semi-aquatique que vous trouvez en Afrique. Comme les autres Naja, il possède la capacité d’envenimation, ce qui fait de lui un serpent venimeux. Il n’a pas la capacité de détecter des proies en […]
Naja multifasciata : Cobra fouisseur ou Cobra aux multiples anneaux
Grand Est, FRANCE, le 25 février 2024, le Naja multifasciata.De : Sébastien KENNEL La description de le Naja multifasciata C’est un reptile que vous trouvez en Afrique et contrairement aux autres Naja, celui-ci est fouisseur. Comme tous les Naja, il possède la capacité d’envenimation, ce qui fait de lui un serpent venimeux. Ensuite, il possède […]
Naja mossambica : Cobra cracheur du Mozambique
Grand Est, FRANCE, le 23 février 2024, le Naja mossambica.De : Sébastien KENNEL La description de le Naja mossambica C’est un reptile qui vous vient d’Afrique et qui est terricole. C’est aussi une espèce qui a la capacité d’envenimation. Comme tous les Naja, ce qui fait de lui un serpent venimeux. Ils possèdent des pupilles […]
Naja melanoleuca : Cobra des forêts ou Cobra noir et blanc
Grand Est, FRANCE, le 22 février 2024, le Naja melanoleuca.De : Sébastien KENNEL La description du Naja melanoleuca C’est une espèce que vous trouvez en Afrique et il est terricole. En outre, comme tous les Naja, ils possèdent la capacité d’envenimation, ce qui fait de lui un serpent venimeux. Ensuite, vous remarquerez qu’il possède des […]
Naja mandalayensis : Cobra cracheur de Mandalay ou Cobra cracheur birman
Grand Est, FRANCE, le 18 février 2024, le Naja mandalayensis.De : Sébastien KENNEL La description de le Naja mandalayensis C’est un serpent asiatique qui est terricole. Et comme tous les Naja, il possède la capacité d’envenimation, ce qui fait de lui un serpent venimeux. Puis, il possède des pupilles bien rondes, ce qui indique qu’il […]
Naja katiensis : Cobra malien ou Cobra cracheur brun d’Afrique de l’Ouest
Grand Est, FRANCE, le 17 février 2024, le Naja katiensis.De : Sébastien KENNEL La description de le Naja katiensis C’est un reptile terricole qui est présent en Afrique. Comme tous les Naja, ils possèdent la capacité d’envenimation. Ce qui fait de lui un serpent qui est venimeux. Ensuite, c’est un animal qui possède des pupilles […]
Naja guineensis : Cobra noir des forêts
Grand Est, FRANCE, le 16 février 2024, le Naja guineensis.De : Sébastien KENNEL La description de le Naja guineensis C’est un serpent qui se trouve en Afrique de l’Ouest, où il est terricole. Il possède la capacité d’envenimation, comme les autres Naja. Ainsi, c’est un serpent venimeux. Puis, il ne possède pas la capacité de […]
Naja fuxi : Cobra à bandes brunes
Grand Est, FRANCE, le 15 février 2024, le Naja fuxi.De : Sébastien KENNEL La description de le Naja fuxi C’est un reptile venant d’Asie de l’Est qui est terricole. Comme tous les Naja, il possèdent la capacité d’envenimation. Ce qui fait de lui un serpent venimeux. Il possède des pupilles bien rondes, ce qui indique […]
Naja christyi : Cobra d’eau du Congo ou Cobra d’eau de Christy
Grand Est, FRANCE, le 15 février 2024, le Naja christyi.De : Sébastien KENNEL La description de le Naja christyi C’est un serpent qui est semi-aquatique et qui est présent en Afrique. En outre, il s’agit d’un reptile qui a la capacité d’envenimation, ce qui fait de lui un serpent venimeux. En revanche, c’est un animal […]
Naja atra : Cobra chinois ou Cobra de Chine
Grand Est, FRANCE, le 14 février 2024, le Naja atra.De : Sébastien KENNEL La description de le Naja atra C’est un reptile qui est terricole venant de l’Asie de l’Est. Il possède la capacité d’envenimation ce qui fait de lui un serpent venimeux. Ensuite, c’est un animal qui ne possède pas de fossette thermosensible. Ce […]